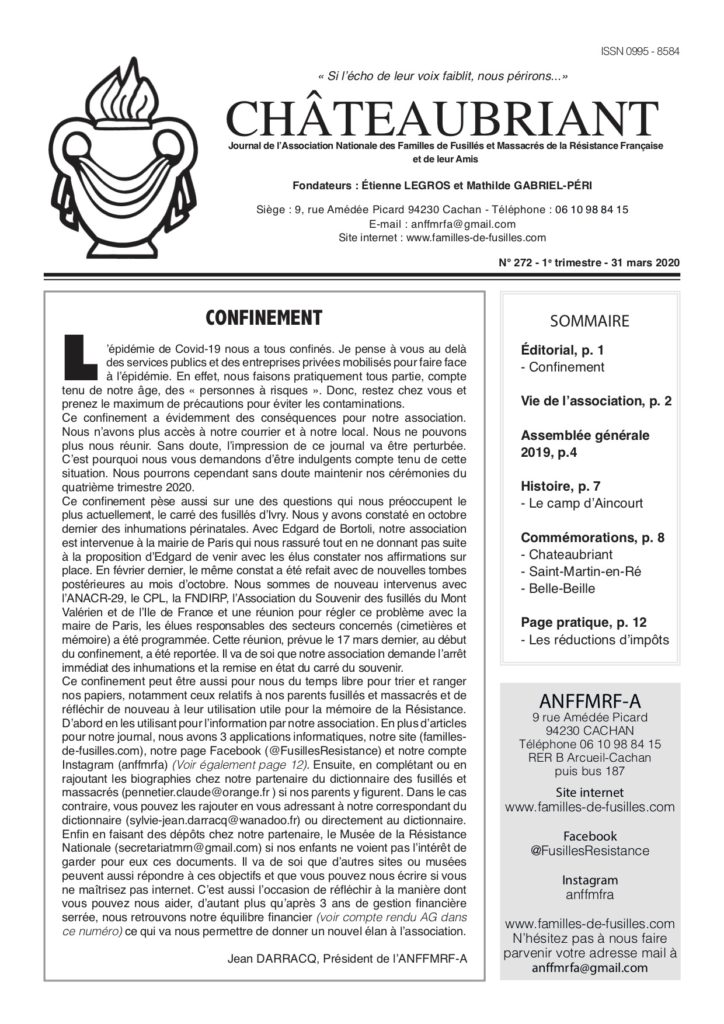Résistant, vétéran, diplomate : à 95 ans, Henri Roqueplo est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur à Chantilly

Le club très fermé des grands officiers de la Légion d’honneur accueille Henri Roqueplo, décoré ce 21 mai en mairie de Chantilly. Aujourd’hui âgé de 95 ans, le vétéran se dit « honoré » d’être ainsi récompensé pour son parcours dans la Résistance puis dans l’armée française.
Engagé à 17 ans dans la Résistance puis officier pendant la guerre d’Indochine (1945-1954), Henri Roqueplo a été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur ce 21 mai, honneur réservé à une centaine de personnes en France.
« Initialement, ce devait être le président de la République qui devait me remettre les insignes. Mais ce dernier a fait savoir qu’il ne pourrait pas se le permettre vu la période, avec les différentes élections, » raconte l’homme âgé de 95 ans, dont l’élévation a été actée dès novembre 2021. Vous savez que seulement une personne de même rang peut vous remettre les décorations, c’est finalement un général qui a pu me les transmettre. C’est très protocolaire : il faut avoir l’accord de la grande chancellerie et on ne leur force pas la main, à ces gens-là ! » La dignité de grand officier est – en quelque sorte – le quatrième échelon de la Légion d’honneur : Henri Roqueplo avait été décoré chevalier de la Légion d’honneur le 28 mai 1962, promu au rang d’officier en 1996, puis commandeur en 2007.
Né le 7 mai 1927 dans le XVe arrondissement de Paris, Henri Roqueplo rejoint ses grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale, qui habitent alors en zone libre à Argenton-sur-Creuse (Indre). Là, encore mineur, il intègre la résistance locale en 1944. Affecté ensuite au 5e régiment des chasseurs d’Afrique (5e RCA), il participe à la campagne de France et celle d’Allemagne, où il reste en tant que force d’occupation à la fin du conflit. Il reçoit la croix de guerre 1939-1945 et son régiment rentre à sa base de Tizi-Ouzou (Kabylie, Algérie). Le jeune Henri est alors accepté à Saint-Cyr. « Il fallait que je reprenne des études, j’avais tout laissé tombé à cause de la guerre, » ponctue le vétéran.