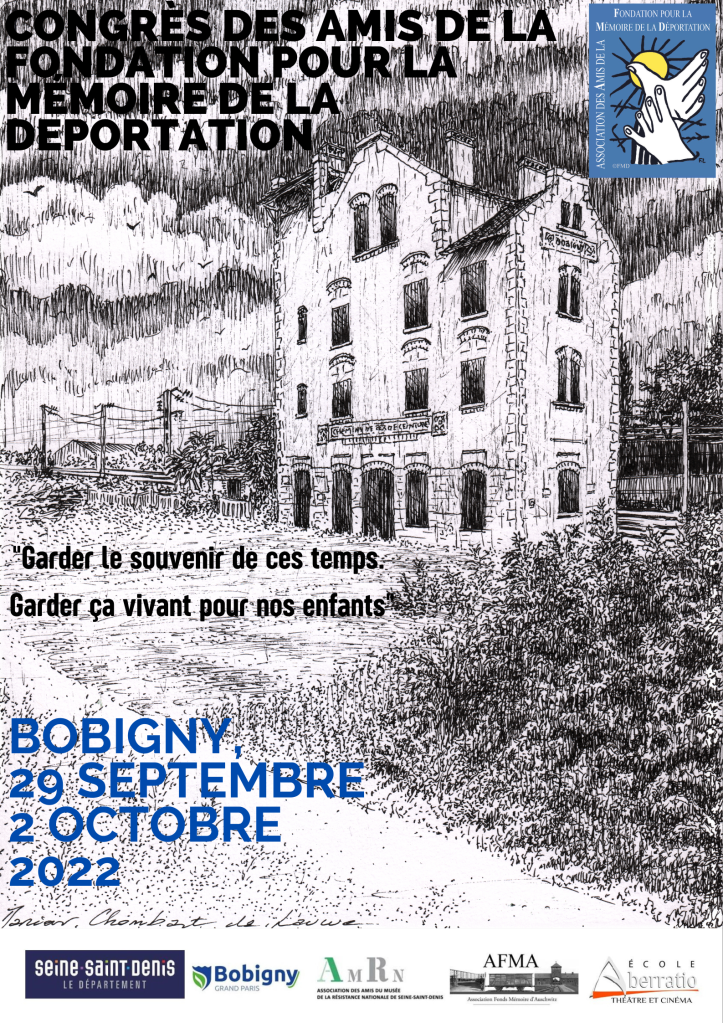Châteaubriant : le nouveau parking de la Carrière des fusillés prend le nom d’Ambroise Croizat



Jean-Marie Guy a été tué le 20 juin 1944 après avoir été torturé par la Gestapo allemande. Ce résistant dirigeait une unité de l’armée secrète dans l’Ain, à Virieu-le-Grand.
C’est l’histoire d’un gendarme dans l’Ain qui a tenu tête aux nazis. Jean-Marie Guy a fait partie de la Résistance française pendant la seconde guerre mondiale. À l’âge de 24 ans, il a été assassiné le 20 juin 1944 par les SS après avoir été arrêté lors d’une mission de sauvetage. Voici son histoire.
Avant de résister contre les Allemands dans l’Ain, Jean-Marie Guy a été fait prisonnier de guerre du 20 juin au 6 août 1940. À Virieu-le-Grand, il est nommé élève gendarme en 1943. Il s’est rapidement engagé dans une forme de résistance contre l’Occupation. « C’était plus une forme de résistance isolée », précise Martial Zanetta.
Le président de l’association Mémoires de l’Ain 1939-1945 connaît bien la vie de Jean-Marie Guy : « Il a intégré la Résistance organisée en octobre 1943 et intègre le maquis de l’Ain. »

Vendredi 30 septembre 2022, le drapeau symbolisant la médaille de la Résistance a été transmis à l’île de Sein (Finistère), ville compagnon de la Libération. Il y restera une année. La cérémonie a réuni plus de 200 personnes.
« Cette médaille est une médaille vivante, qui continue d’être remise », indique Pascal Blanchetier, secrétaire général de l’Association nationale des communes et collectivités médaillées de la Résistance française (ANCMRF). « Beaucoup de héros de la guerre n’ont pas parlé de leur vécu à leurs enfants, à leurs proches. Il y avait beaucoup de souffrance… Ce sont souvent les petits-enfants qui, à travers des bribes de paroles familiales, des archives, découvrent et font valoir les mérites de leurs aînés. »

Dimanche, le comité d’Ussel et sa région de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance célébrait le 79 e anniversaire des combats du Bois des Trois Faux, sur la commune de Couffy-sur-Sarsonne. Cette cérémonie s’est déroulée au village de Réjat sur les lieux même des combats au camp « Vincent Faïta » des maquis FTP. Au cours des combats qui se déroulèrent dans la nuit du 26 au 27 septembre 1943, quatre résistants tombèrent sous les balles ennemies. Raymond Louradour, François Lentsch, Jean-Marie Perruchon et Roger Thibault. Cinq de leurs camarades furent faits prisonniers, déportés et moururent dans les camps de la mort. Tous faisaient partie de ces 120 résistants qui occupèrent le camp Vincent Faïta. « C’est là que se trouve notre devoir de mémoire. Il ne faut pas oublier les combats de la Résistance française pour la défense des valeurs de liberté, égalité, fraternité, justice ». L’année 2023 sera celle du 80 e anniversaire. « Mobilisons-nous pour que l’hommage soit à la hauteur du sacrifice des camarades assassinés et déportés, du Bois des Trois Faux et de l’ensemble des combattants de la liberté », fut-il dit lors de l’hommage.

Qu’elle soit assumée, secrète ou symbolique, la résistance fait bel et bien partie de l’histoire de la musique. Voici un tour d’horizon de l’œuvre musicale comme acte de résistance.
Aborder la résistance en musique nécessite d’abord de distinguer les différentes formes de résistances possibles. Certes l’acte de résistance peut être exprimé à travers la musique, mais la composition d’une œuvre musicale peut elle-même incarner un acte de résistance. Certains actes dépendent de l’intention du créateur ou de l’interprète, mais d’autres dépendent de l’interprétation de l’œuvre et de la signifiance symbolique qui y est ensuite associée. On peut résister par l’absence de musique, ou en incorporant dans sa musique des éléments subversifs de manière plus subtile et cachée.
On trouve ainsi la résistance musicale sous des formes diverses, résonnant à travers toute l’histoire de la musique.

Temps de lecture : 8 min
Tout le monde connaît l’ordre de la Libération : les fameux compagnons, 1 046 membres d’une chevalerie de la France libre. Ils sont tous décédés. Or une autre décoration est née, elle aussi des combats, dont les Français ignorent presque tous l’existence : la médaille de la Résistance française. Si l’ordre fut créé dès le 16 novembre 1940, il fallut attendre le 9 février 1943 pour que le chef de la France combattante – et non plus le chef de la France libre – sorte de son chapeau cette médaille. En difficulté face au général Giraud couvé par les Américains, le général de Gaulle y voit l’occasion d’asseoir son emprise sur les forces intérieures qu’il tente d’unifier au même moment grâce à Jean Moulin. Mais la récompense fut plus largement distribuée, puisque remise, entre 1945 et 1947, à…
Consultez notre dossier : « Le Point » a 50 ans !
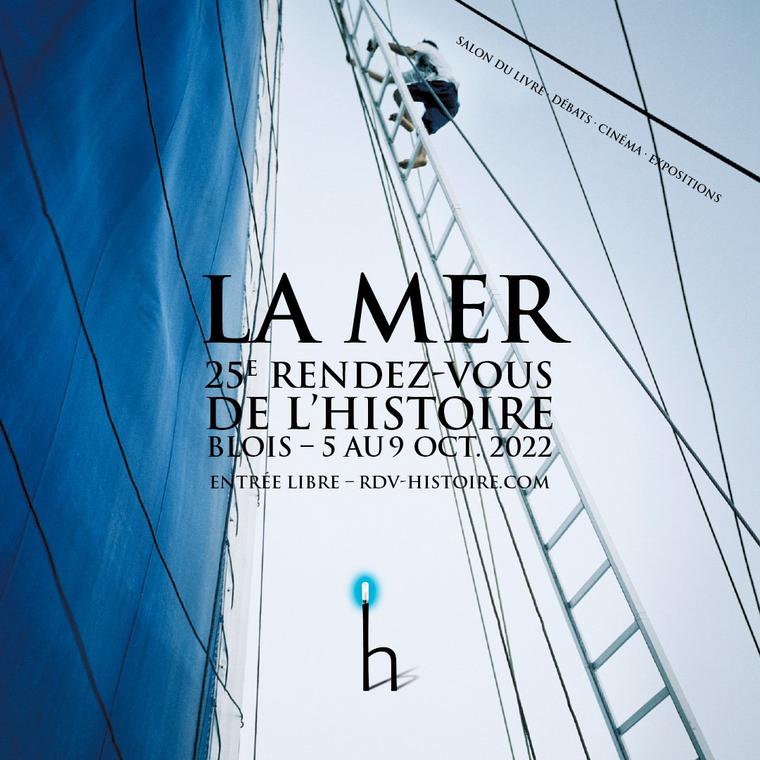
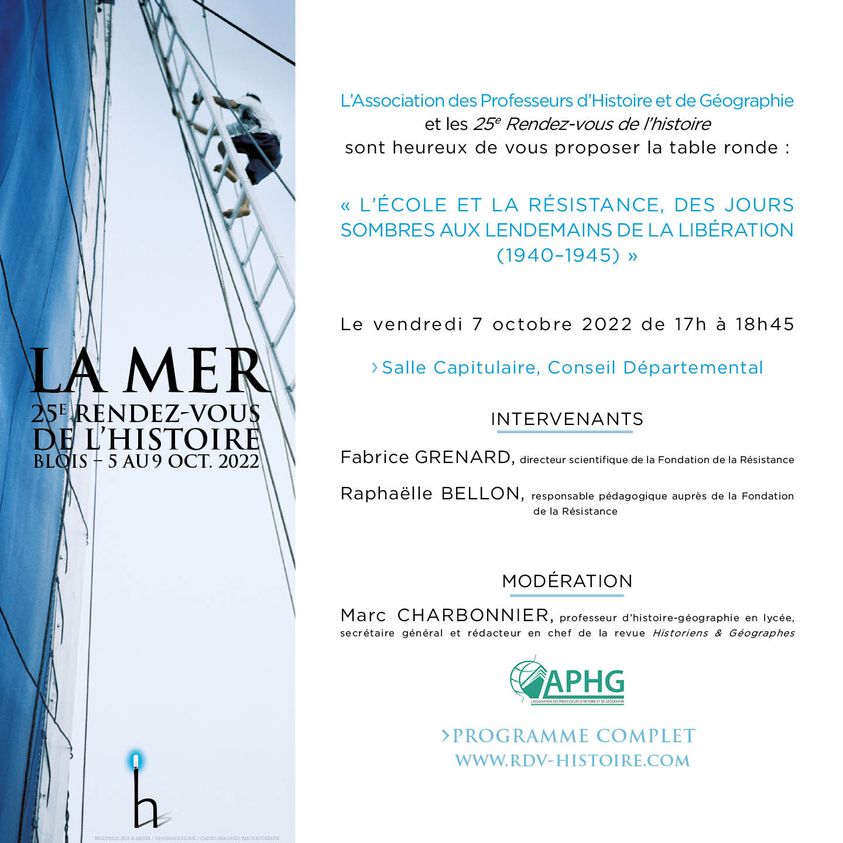

Le Congrès national de l’association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation se déroulera du 29 septembre 2022 au 2 octobre 2022 à Bobigny.