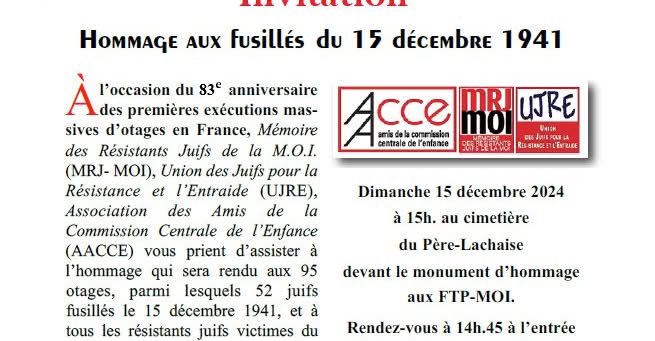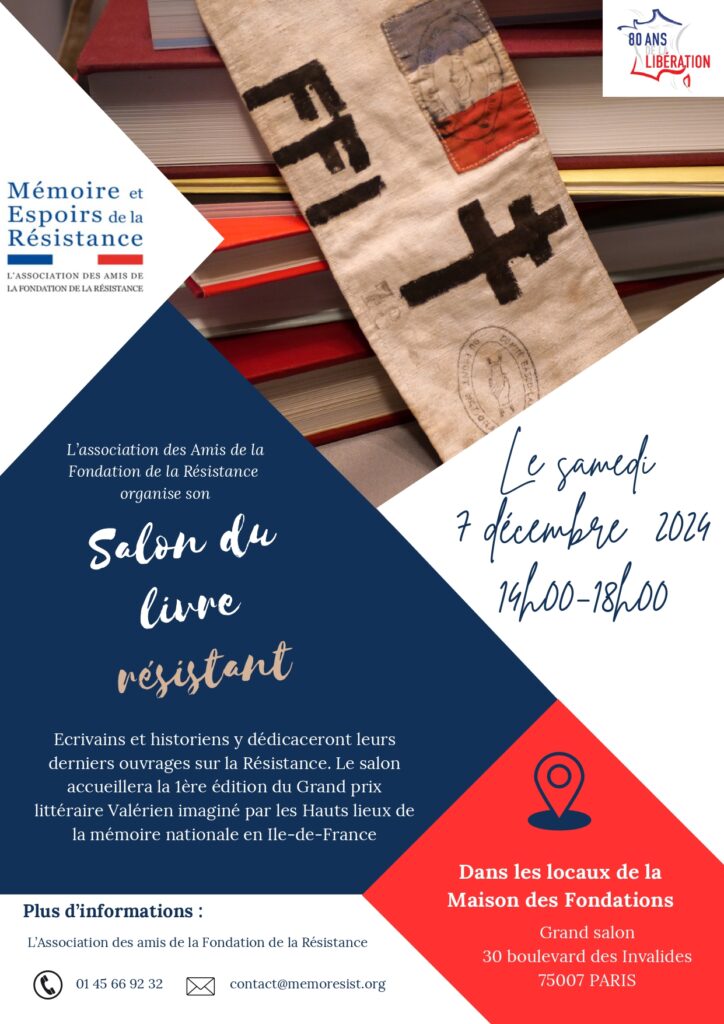Dans le cadre du projet scolaire « valise mémoire »
Berty Albrecht – Henri Frenay : comment s’aimer dans la France occupée

Aujourd’hui dans Affaires Sensibles… Berty Albrecht – Henri Frenay : comment s’aimer dans la France occupée.
Leurs noms n’évoquent plus grand-chose. Pour quelques hommes restés dans la mémoire nationale – Jean Moulin, Brossolette, Guy Môquet – combien de milliers d’autres le temps a-t-il effacés ? En particulier, combien de résistantes ont-elles été reléguées au second plan d’une mémoire fabriquée et entretenue par des hommes ? Parmi ces femmes injustement traitées, il y a Berty Albrecht. Elle a pourtant fondé avec son compagnon Henri Frenay le mouvement le mieux constitué de la Résistance : Combat.
C’est une histoire de lutte et d’amour que nous vous racontons aujourd’hui. Celle de l’union, dans la clandestinité, de deux individus que leurs opinions opposent parfaitement : une femme de gauche, un homme de droite ; une protestante, un catholique ; une féministe d’avant-garde, un militaire traditionaliste. Comment ce couple improbable a-t-il fait naître un grand mouvement de Résistance ? Comment s’aimer quand Vichy et les nazis sont à vos trousses ? Et quelle place donner aux sentiments quand la mort peut frapper à chaque instant ?
L’exposition « Tout une histoire ! Michelin dans la seconde guerre mondiale »

Le musée de la Résistance à Chamalières propose actuellement « Tout une histoire ! Michelin dans la seconde guerre mondiale », une exposition temporaire qui retrace l’histoire de la manufacture pendant la seconde guerre mondiale. Des objets, films et documents font revivre cette époque complexe.

Avec Jean-Luc Guillet et Christine Perraud (directrice du Musée de la Résistance).
Tout une histoire ! Michelin dans la seconde guerre mondiale
A voir jusqu’à fin septembre 2025
Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation
7, place de Beaulieu à Chamalières
Ouvert du du lundi au samedi de 13h00 à 18h00
Fermé les jours fériés
« Résister ! » : Une plongée immersive dans l’histoire de la Résistance française

Dans le cadre du 80ᵉ anniversaire de la Libération, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG) a organisé une exposition intitulée ** »Résister ! »** à la Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville à Tarbes. Jusqu’au 30 novembre 2024, cette exposition rend hommage aux résistants français à travers des reconstitutions historiques, des documents, des objets d’époque, des témoignages et des photos.
L’inauguration a été marquée par la présence émouvante de Léon Layré, le dernier résistant Haut-pyrénéen, âgé de 100 ans. Il a salué la mémoire de tous les soldats et résistants morts au combat et a félicité les organisateurs pour cette initiative mémorielle.
Participez au Gala du 80ème anniversaire de la Libération des Déportés CONCERT DE LA LIBERTE
Sur les traces en Creuse de l’historien et résistant Marc Bloch, bientôt panthéonisé

Après l’annonce de la panthéonisation de Marc Bloch le week-end dernier par Emmanuel Macron, la fierté envahit le Bourg-d’Hem. C’est dans cette commune de la Creuse que l’historien et résistant a vécu et où il repose.
Au bout d’une allée du cimetière du Bourg-d’Hem en Creuse, le caveau familial des Bloch est encerclé de tombes. Sur ce caveau en granit gris, aucune plaque mais deux mots dorés gravés : « dilexit véritatem », en français « aimer la vérité ». C’est ici que Marc Bloch repose, aux côtés de six proches à lui.
Depuis l’annonce de la panthéonisation du résistant et historien Marc Bloch, samedi 23 novembre, la question de l’avenir des cendres se pose. « Partir à Paris c’est laisser sa famille et il était très attaché à elle », estime Claudine, une habitante d’une commune voisine. « Ce serait quand même mieux parce qu’il reste ici d’autant qu’il est d’ici ». Marc Bloch est né à Lyon mais il venait régulièrement en été dans la maison familiale située dans le hameau des Fougères. « C’est ici qu’il a écrit L’étrange défaite », souligne Robert Deschamps, la maire de la commune. Cet ouvrage est le plus connu de l’historien, il cherche à comprendre les raisons de la débâcle française en juin 1940. Derrière la grille rouillée se dévoile une bâtisse, elle appartient toujours à la famille Bloch.
Série « La guerre des ondes (1939-1945) » Épisode 5/6 : Les points de fixation

Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les propagandes croisées de Radio Londres, Radio-Paris et Radio-Vichy jalonnent l’évolution du conflit. De la question des otages à celle du Service du travail obligatoire, retour, en archives, sur quelques points de fixation.
Avec
Laurent Douzou Professeur émérite d’histoire contemporaine à Sciences Po Lyon et à l’université Lumière Lyon 2
À l’été 1941, avec la Résistance qui s’organise, les attentats se multiplient contre des Allemands sur le sol hexagonal. En riposte, de plus en plus de Français sont pris en otage et nombre d’entre eux sont fusillés pour l’exemple. Sur les ondes de la BBC, on s’en fait l’écho. S’ensuivent une série de prises de parole sur les chaînes de radio des différents camps.Le Service du travail obligatoire (STO) fait suite à un dispositif connu sous le nom de « Relève » qui consiste à libérer un prisonnier pour tout Français qui partirait travailler en Allemagne. Ce système, basé sur le volontariat, n’ayant pas rencontré le succès, partir travailler en Allemagne devient obligatoire, et des centaines de milliers de jeunes Français sont sommés de soutenir l’effort de guerre de l’ennemi. Le principe est présenté différemment sur Radio-Vichy et Radio-Paris. Sur le thème du STO comme sur celui des otages, les radios, plongées dans la guerre, passent quatre années à tenter de convaincre et de gagner les consciences à leur camp.`